 |
Sur
Rem Koolhaas, année 90 @ O.M.A.
Référence : Chaîne, Schème
Daniel Guibert
Référence
« Faire
référence à... » signifie encore pour beaucoup
de créateurs ou de concepteurs (notamment architectes) “ copier ”
ou « imiter » la matière d’œuvres
du passé ou même contemporaines. Des culpabilités douteuses
restent qui suivent les jugements de valeurs négatifs attachés
aux procédures référentielles. Pour aborder la référence
il est opportun de l'extraire des pratiques absurdes de sa mise au secret :
elles sont soutenues par des interdits encore vivaces, issus d'une conception
de la création à l'image du génie ou du modèle divin
de la création ex abrupto. La référence constitue
pourtant un objet d'étude essentiel pour une connaissance des processus
de création ou de symbolisation ; et les savoirs du fonctionnement
référentiel participent selon nous de l'entreprise qui vise une
théorie de la projection et de la conception.
Aborder les problèmes (éthiques, esthétiques,
méthodologiques, ...) de « faire référence
à ... » comme nous le faisons ici suppose d'abord leur
cadrage par une représentation qui serait de la forme logique :
mise en relation conjonctive ou disjonctive de cas passés (invoqués,
convoqués) et de cas futurs (projetés, prévus). L’application
de cette forme générale dans le domaine Architecture s’écrit
de la manière suivante :
Induite par une commande ou une demande de prévision
et d'actualisation d'une configuration nouvelle et virtuelle, encore inexistante,
un composé indissociablement architectonique et urbanistique, une relation
s’établit entre (1) des objets appartenant à une classe
d’objets convoqués par cette demande, (2) d’autres classes
d’objets métaphoriquement ou métonymiquement associés,
et (3) des descriptions anticipatrices immédiatement et intentionnellement
conçues. La résolution des problèmes de référence
passe alors par l'explicitation des modalités et procédures de
mise en oeuvre de cette mise en relation et leurs conséquences dynamiques
pour la conception-cognition d’un objet futur.
Ainsi situés, les problèmes liés
à la référence impliquent un effort de compréhension
spécifique. Il s'appuiera évidemment sur toutes sortes d'apports
de disciplines diverses — auxquels il est fait référence ici —
qui nous informent de l'état d'avancement des connaissances en matière
d'invention, de création ou de projection, dont le moindre n'est pas
pour nous celui d'une recherche en logique impliquée dans cette communication
[1]. Cet effort de compréhension, outre son rapport
à la logique, se fonde conjointement soit sur l'étude en temps
réel de situations empiriques de conception [2], soit
sur la participation active à de telles entreprises chaque fois que cela
s'avère possible dans le cadre d’une activité de concepteur
et non plus de chercheur.
Pour rendre tangible un état de la question,
sera résumé dans ce qui suit l'examen d'un point crucial du processus
de conception mise en oeuvre par l'Office for Metropolitan Architecture
(OMA) de Rem Koolhaas. Le processus étudié s'exerçait
dans le cadre d'un concours international « d'urbanisation multiple »
instruit par les responsables politiques et techniques de la ville de Courtrai
(Belgique). Les termes du concours diffusés aux concurrents sélectionnés
(documents graphiques de tous ordres, conférences et visite organisée
du site, etc.) constituent et clôturent la phase de projet. Pour simuler
l'essentiel des détours de cette réflexion sur la phase de conception
engagée par le concurrent OMA, nous ferons état du moment
où, durant la conception, s'est recomposé le matériel référentiel
et où se sont nouées les conditions d'enchaînement d'un
cas d'autoréférence et d'un cas de référence homogène
et explicite.
Concept rétroactif et logique d'identification
Au
cours d'un entretien-bilan avec Rem Koolhaas, consécutif au suivi de
sa tentative pour concevoir une nouvelle organisation du territoire périphérique
du Haut Courtrai et de relier ce territoire à la ville ancienne, fut
abordée la question de l'évolution des termes qui rendaient compte
de la dynamique de cette conception, depuis l'analyse du site jusqu'à
la rédaction de son texte de présentation synthétique aux
membres du jury. Dans le cas présent, celui du projet pour planifier
le territoire du Haut Courtrai (Figure 1), la question que je lui adressait
s’énonçait ainsi :
« Y avait-il eu formation d'une terminologie
de base spécifique, adaptée, qui permettait de fonder une réorganisation
de ce qu'il nommait « chaos périphérique »
? Ou bien le recyclage de catégories déjà expérimentées
avait-il été déterminant pour cette prévision d'un
surprenant réalisme urbanistique ? »
Ses réponses furent les suivantes :
RK : « (...) Je pense que dans
ce sens le projet pour Courtrai est comme une sorte de mini Anvers,
car nous avions là un contexte extrêmement complexe [il s'agit
du concours organisé la même année par les édiles
d'Anvers pour restructurer les limites de la ville marquées par le Ring
et ses raccordements aux infrastructures externes, concours auquel avait participé
l'OMA, concours gagné par l’architecte japonais Toyo Ito].
Contexte qui n'était pas structurable avec des moyens classiques. Le
seul moyen de le structurer était d'inventer des formules pour reconnaître
et identifier les différents terrains ainsi que leur potentiel.
Cela implique que toute situation topographique que l'on ne peut pas identifier
avec des formes ou des concepts classiques comme le triangle, le cercle, l'axe
etc. doit être précisée par d'autres moyens qui peuvent
être métaphoriques, plus suggestifs et a priori moins
générateurs d'ordre géométrique. C'est l'intérêt
de la chose, car une telle formulation ne met pas directement en oeuvre un programme
qui impose un ordre architectural classique.
Par exemple l'« oeuf » est parti
d'une idée absolument littérale pour aboutir à un concept
relativement abstrait qui n'est pas vraiment en rapport avec l'idée que
l'on peut se faire d'un oeuf. C'est donc un terme qui, une fois établi,
suggère un spectre d'interprétations. »
 |
Figure
1 (format original en A4)
Concours d’Anvers : page de garde de la plaquette présentant la
conception d’OMA
DG : « Ces
moyens métaphoriques correspondent-ils à ce que vous nommez des
concepts opératoires ? Vous avez d'ailleurs surtout utilisé
le terme concept rétroactif. Quels rapports établissez-vous
entre « métaphore », « concept opératoire »
et « concept rétroactif » ? »
RK : « Il est possible d'avancer
qu'à Anvers aussi bien qu'à Courtrai nous n'avons pas à
traiter un espace vierge ; la situation est déjà très
compliquée. Très riche, parce qu'il y a partout des éléments
d'architecture contemporaine, historique, classique... Le tissu référentiel
était très dense.
Le concept rétroactif est donc une façon
de ne pas perdre tout espoir car a priori on peut dire que les situations
d'Anvers et de Courtrai sont assez chaotiques. De plus, les infrastructures
déjà présentes représentent des interventions très
brutales, introduisant des ruptures significatives dans un contexte en lui-même
assez délicat.
L'idée du concept rétroactif ne signifie
donc pas qu'il est possible de trouver une logique rétroactive mais,
qu'en revanche, on peut s'efforcer à tout prix de trouver une logique
qui puisse identifier des débris ; c'est-à-dire une logique
qui puisse, à l'intérieur des débris, identifier un certain
potentiel. C'est cela que l'on appelle le concept rétroactif. Cela permet
de trouver, dans le chaos, des modèles de commencement ou de recommencement
qui sont moins minables. [3] »
Manhattan-Berlin-Anvers-Courtrai : une chaîne
référentielle
Comme
le projet pour le concours d'Anvers a donné lieu à une conception
signée OMA (Figure 1), le projet pour Courtrai, « mini
Anvers », se range dans la catégorie « autoréférence
homogène explicite », et plus précisément une
catégorie que l’on pourrait nommer « autoréférences
explicites à objet de valeur unique ». Dans cet ordre classificatoire,
le projet pour Anvers est-il lui-même auto-référentiel ?
Ou appartient-il à une catégorie de références ouvertes,
mais au contenu implicite et hétérogène ? Ou encore
à un mixte de ces catégories ? Pour répondre à
ces questions, il m'a fallu reconstituer un parcours référentiel
au travers de la plupart des projets des années 80. Le fil conducteur
de ce parcours involutif ou rétroactif sera le terme « île ».
Pourquoi ce terme plutôt qu'un autre ? Déjà utilisé
dans la réponse au concours pour la ville nouvelle de Melun-Sénart
(1987), il apparaît dans l’univers de conception pour Courtrai de
façon déterminante : il sera suggéré par Rem
Koolhaas pour dénouer une situation intentionnelle dépressive
de l’équipe de conception qui s'avérait effectivement assez
désespérante par manque de cohérence et d’enthousiasme.
La puissance instauratrice et centripète de la métaphore de l’«
île » jouera alors son rôle de « modèle
de commencement ou de recommencement ». De recommencement surtout,
tant il me semble alors justifié de rapporter aux situations de conception
d’Anvers et de Courtrai (1) une lignée de prestations de concours
des années 80, et (2) celles-là aux « manifestes »
écrits ou dessinés par Koolhaas qui les accompagnent, (3) manifestes
qui trouvent conséquemment leur source personnalisée dans le Delirious
New York que Rem Koolhaas a publié en 1978 [4].
Cet ouvrage est devenu référence « théorique »
incontournable pour une réflexion sur le mode de conception pratiquée
par OMA comme il l’est des modalités de compréhension
de la forme urbaine contemporaine pour nombre de concepteurs dans le monde.
De fait, la « culture de la congestion »
et son objet privilégié le « gratte-ciel » (IGH) décrits
par Koolhaas dans Delirious New York ainsi que la doctrine du « manhattanisme »
qu’il y expose et théorise, prennent diversement source et surtout
force de référence spatialisante tridimensionnelle. D’abord
dans l'analyse historique de la forme urbaine réelle de l’île
de Manhattan, son origine primitive géographique et indienne, les
combats victorieux pour l’indépendance qui s’y livrent, surtout
les coups de force politiques d’aménagements audacieux tels son
plan en damier ou le canal de raccordement au lac Erié qui modèlent
et adaptent son vaste territoire à une dynamique d’implantation
conquérante et lui confère un statut économique sans précédent.
Par suite, l’île de Manhattan sera « revisitée »
comme île première, mythique, d'un nouvel imaginaire urbain,
social et national, enfin comme valeur symbolique de toute édification
politique en matière d’urbanisme moderne hors du « vieux
continent » et hors des valeurs du « mouvement moderne »
des urbanistes et architectes des années 20. Elle constitue d’ailleurs
pour Koolhaas ce qu’il nomme « la pierre de Rosette du XXe
siècle » ou encore, quelque chose comme « la nouvelle
Babel et son dépassement [5] » . L'île
de Manhattan lui permet ainsi de fonder historiquement et imaginairement son
« manifeste rétroactif », rétroactif notamment
par rapport à l’ordre établi de la Charte d’Athènes.
Il est également nommé par R. Koolhaas « manifeste
d'urbanisme pour le XXe siècle [6] »
, au sens où il devrait être le seul vrai manifeste possible en
la matière. Au lieu de se fonder d’un concept d’« Unité
d’habitation » comme « Machine à habiter » industrialiste
et « industrialisée » et son zoning urbain hygiéniste
conséquent, il se fonde sur un concept d'île opérative,
collectivement ludique et délirante, à la fois réelle,
symbolique et imaginaire :
« Entre 1890 et 1940, une nouvelle culture
(l'ère de la Machine) choisit Manhattan comme laboratoire : île
mythique où l'invention et l'expérience d'un nouveau mode de vie
métropolitain et de l'architecture qui lui correspond, peuvent se poursuivre
comme une expérimentation collective qui transforme la ville tout entière
en usine de l'artificiel, où le naturel et le réel ont cessé
d'exister. [7] »
Sous emprise de ce dispositif doctrinal « isolâtrique »,
faisant fonction de « Théorie disciplinaire de la Métropole
contemporaine », et de son objet théorique un édifice
idéal manhattanien ambivalent, il est alors pensable de définir
l’appareil doctrinal à l’œuvre en ces cas de conception
analysés. Cet appareil se compose, comme en bien d’autre cas de
formation doctrinale d’ailleurs, de trois logiques imbriquées :
(1) une logique de fondation, attachée-là à l’Ile
Manahattan, à laquelle s’associe consécutivement (2) la
logique de distinction hiérarchique (identification ordonnée de
tout ce qui peut s'identifier et se conformer à l'image d’une île-Ile)
et (3) une logique de détermination par projection des propriétés
déterminantes d’un cas passé d’urbanisation architecturée,
« isolationniste » et « congestionnante », sur toute
urbanisation future. Toutes ces logiques sont propres à la formation
discursive opératoire doctrinale relative à la conception d’artéfacts
de tous types et au moins celle spécifique au domaine Architecture.
Suivant l'usage opératoire du terme « île »
ou « îlot » dans des projets antérieurs à
ceux d'Anvers et de Courtrai (1990) — celui par exemple explicite mis en
pratique pour Melun-Sénart (1987) —, il est aisé de constater
enfin ceci : cet usage visait une caractérisation des états territoriaux
existants (des cas passés) en terme de « débris »
; il jouait alors un rôle structurant (rétroactif) dans la formation
des solutions urbaines et architecturales au problème de la fragmentation
de l’espace des lieux offerts aux concours, qu’il s’agisse
de « débris » d’une urbanisation commencée
il y a longtemps, tel celui du territoire de Courtrai (ou d’Anvers) ou
d’une urbanisation récente telle celle d’une « ville
nouvelle », promue sur un territoire anciennement urbanisé
comme Melun-Sénart.
Cette fragmentation, dans la terminologie de Koolhaas
quand il use du terme « débris », pouvait encore
être comprise comme brisure, comme éclatement d’une unité
imaginaire (miroir, glacis, assiette de projets passés-dépassés-trépassés,
surface-plan d’inscription d’aménagement territorial, ...).
Cette unité imaginaire serait celle d’une ville fantasmatique qui
aurait été, d’une totalité harmonique ordonnée
et harmonieuse, dont seuls quelques débris témoigneraient encore,
ou dont les débris seraient à ramasser d’abord, puis à
sélectionner pour leur conservation, à ressasser.
A moins qu’il ne s’agisse des débris réels d’un
désordre précédent, aux équilibres temporellement
précaires, débris ordonnés seulement imaginairement, rattachés
à ces états antérieurs du processus d’urbanisation
des campagnes, des bourgs et des villages. Toutes ces opérations référentielles
composées à partir d’une mémoire historique et d’une
mémoire quasi mythique, configurent les modalités créatrices
de l'invention du nouveau et du divers. Elles sont modalités d'un univers
de référence, modalités génératrices de configurations
d’émergences ; elles procèdent ainsi des opérations
d'une poïétique intentionnelle de conception que cet univers référentiel
suscite, et qu’on peut tenter de reconstituer selon ses enchaînements
plus ou moins secrets et sa schématique instauratrice enfin explicitée,
révélée.
Iles, îlots, Archipel vert
Dans
le projet pour Courtrai, dès que fut introduit le terme « île »,
concept opératoire et rétroactif nodal, concept-clé du
« manhattanisme » inscrit dans la « tradition »
de l'OMA, concept fédérateur et génératif des énergies
et dynamiques de conception, la chaîne référentielle se
noue; elle se noue non seulement entre le concours pour Courtrai et celui pour
Anvers mais entre le projet pour Anvers et un projet fictif pour Berlin, entre
ce dernier et la doctrine-mère conclue en 1978.
Quant au projet pour « un Berlin théorique »,
il fut élaboré dans un séminaire organisé en 1976
à l'Université Cornell (Ithaca, Pensylvanie) par Oswald Mathias
Ungers, séminaire auquel évidemment Rem Koolhaas participa. Au
cours de ce séminaire écrira-t-il dix ans plus tard [8],
« un concept fut lancé qui ne semble pas jusqu'à présent
avoir fait fortune » : « archipel vert ». On
peut dès lors former la chaîne référentielle suivante
: « Delirious New York » – « projet-pour-Berlin »
– « projet-pour-Melun-Sénart » — « projet-pour-Anvers »
– « projet-pour-Courtrai ». A condition d'admettre que
si le terme « île » n'est pas explicitement utilisé
dans le « projet-pour-Berlin », il est cependant contenu
dans la métaphore de l'archipel. En suivant les expressions métaphoriques
des articles et textes accompagnant les projets, on peut le modaliser ainsi :
(1) «Archipel » : ensemble structuré d'îles situées
dans un océan, (2) « Archipel vert » : comme les
océans qui couvrent la plus grande surface de la Terre, l’urbanisation
planétaire galopante se diffuse par taches urbaines (métropolitaines)
de sur-densification artéfactuelle et démographique, qui contaminent
la surface naturelle de la Terre ; l’archipel des îles et îlots
de verdure qui résistent à cette prolifération constituent
un « néant » d’urbanisation fait de vides,
de sous-densités, où l’absences des propriétés
architectoniques et urbanistiques attachées au réalisme classique,
puis au progressisme moderne, seraient constatables. Quand Koolhaas fait l’apologie
des sur-densifications manhattanistes d’activités entremêlées,
il le fait contre l’idéologie du « mouvement moderne »
des densités contrôlées et harmonieusement réparties
par zones fonctionnelles. Comment peut-il alors, quasi simultanément,
revendiquer les sur-densifications manhattanistes et « imaginer le
néant », promouvoir un paysage urbain composé d’« effacement
post architectural » sur le mode de Central Park ? C’est-à-dire
imaginer la distribution réglée de sous-densités extrêmes
qui vont jusqu’à l’intention de détruire les densités
existantes qui n’auraient aucune valeurs reconnaissables, celles qui ne
le « méritent pas », et conserver, voire consolider,
celles étant chargées des valeurs immanentes pouvant résister
à celles de l’ « île » ?
Remarques : ces valeurs invoquées de toutes
discriminations des densités construites restent assez fluctuantes sinon
évanescentes, sauf à considérer, s'agissant du projet pour
« un Berlin théorique », que certaines constructions
réelles (la Porte de Brandebourg ou un quartier historique ayant échappé
aux destructions massives de 1945) seront jugées dignes d’être
conservées, pour de multiples raisons inexplicites, ou même des
constructions situées mais jamais construites, telle le projet de Tour
de verre (lequel ? Il y en eu plusieurs), immeuble de bureaux conçu
en 1922 par Mies van der Rohe pour la Frichstrasse, qu'il s'agirait enfin de
construire, valant par-là comme redoublement référentiel
des « beaux exemples » académiques. Paradoxalement,
ce sont pourtant bien ces propriétés urbaines insidieuses, insinuées,
les dispositions métropolitaines de ce "néant", du néant
architectonique d’un océan urbain peuplé d’îlots
verts ou d'objets sacralisés, d’un « non-aménagé »
urbanistiqu, que Koolhaas exhorte (déjà) à imaginer. Ce
sont ces propriétés déconstructives d’un imaginaire
technique de toute modernité qu'il recherchera avec acharnement, jusqu'au
projet pour Courtrai et au-delà. Car maintenant, elles s'instituent ces
propriétés, ces valeurs dispositionnelles, au moins par le coup
de force médiatique de l'AMO, le nouvel Office new
yorkais de Rem Koolhaas, dans un contexte d’« unmaterial world »
stigmatisé par son manifeste pour l’« unbuilding »
et l’« undesign [9] ».
Exemplification, transfert de propriétés,
autoréférence
A partir de la chaîne référentielle à géométrie imaginaire variable (dîte ci-dessus), introduite par l'expression "mini Anvers", l'examen de la relation Anvers-Courtrai fait ressortir dans son foisonnement référentiel son obéissance à l'un au moins des théorèmes du « faire référence à... » qu'est l'autoréférence. Ces théorèmes sont énoncés « à titre indicatif » par Nelson Goodman [10]. Si cette logique référentielle se présente, en résumant N. Goodman, généralement comme suit :
(1)
« Si Y fait référence à X »
(2) « Alors X exemplifie Y »
(3) « Si X exemplifie Y, alors Y dénote
X ».
alors dans
l’énoncé de Koolhaas : « Courtrai est comme une
sorte de mini-Anvers », Anvers constitue une référence
forte et unitaire pour Courtrai (Figure 2), de même qu'Anvers suit les
traces de Melun-Sénart, qui poursuit le « un Berlin théorique »
qui prolonge la tradition manhattaniste « théoriquement »
revisitée.
Le dernier maillon de la chaîne (Y= projet-pour-Courtrai) exemplifie selon
la proposition (2), même en mineur, son antécédent (X= projet-pour-Anvers)
parce qu’il lui aurait fait référence (1) par l’introduction
du concept rétroactif « île ». Lui sont alors
attribuées, transmises, certaines des valeurs définies dans le
projet-pour-Anvers. L'exemplification est une modalité de la représentation
où l'objet virtuel à concevoir (cas futur) se voit affecté
certaines des propriétés au moins de l'objet de référence
qu'il représente (cas passé, le bon exemple ou la série
des solutions liées par un même problème [11].
La métaphore-concept « île » constitue alors
l'opérateur privilégié du transfert de propriétés,
de dispositions. En tant qu’opérateur de la reconnaissance d'une
exemplification, il procède par description d’attributs et par
délimitation d’une possession : Courtrai devrait posséder
tout ou partie des valeurs d’Anvers.
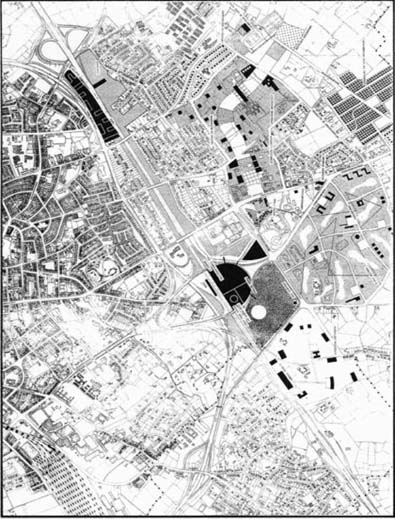 |
Figure
2
Concours d’urbanisation Multiple du Hoog Kortrijck :
Plan d’ensemble de la conception d’OMA
Maintenant,
si tel qu’il est dit dans la proposition (3) ci-dessus, Courtrai dénote
Anvers, cela signifie que le conséquent dénotant l’antécédent,
il en signifie le dénoté, soit : les valeurs urbaines, plastiques
et symboliques de la série des solutions qu’induisent le concept
opératoire d’ « île », série de solutions
reliées par la forme abstraite ou mentale du problème de l’urbanisation
contemporaine que Koolhaas désigne : Comment faire pour ne plus densifier
à la manière proliférante des « modernes »,
notamment par excès d’architecture ? Comment procéder
à l’inverse par condensations ponctuelles ménageant une
disponibilité territoriale pour la constitution de lieux de « détente »
ou d’activité détendue dans l’océan de verdure ?
La « référence à... » d'abord, la
distribution de la possession de tout ou partie des propriétés
transmises ensuite, constituent les conditions de l'exemplification et pratiquement
l'un des événements parmi les plus déterminants d'une poïétique
architecturale et urbanistique. Mais quand la référence s'organise
à partir d'un cas passé déjà conçu par le
même concepteur qui y fait référence dans un nouveau contexte,
nous sommes en présence évidemment d’une auto-exemplification
ou auto-référence.
Quant le maillon antécédent (X=Anvers)
est dénoté par le dernier (Y=Courtrai) ce dernier possède
alors la faculté de désigner par extension tous les projets appartenant
à la classe de ceux pensés à l'aide du complexe métaphorique
île-archipel vert, qui structure le projet pour « un
Berlin théorique ». Il délimite par-là un univers
de référence homogène. La relation Anvers-Courtrai
est donc auto-référentielle parce qu'il y a auto-exemplification.
De même, dans la relation Berlin-Anvers, le second maillon exemplifie
à son tour le premier, alors que, par la métaphore de l'archipel,
Berlin dénote tous les projets conçus avec son soutien métaphorique.
Par contre, reste l’énigme liée
au fait que le schème de l'archipel n'est pas explicitement revendiqué
par Koolhaas comme ayant été formé par lui. Dans le cas
contraire, il ne s'agirait que d'une exemplification simple et non d’un
cas d’autoréférence, sauf à inclure tous les participants
du séminaire d’Ithaca en une seule entité subjective référentielle.
A ce propos, à ma connaissance, Léon Krier serait peut-être
le seul des participants à avoir reconduit dans ses études de
conception le modèle de l’« archipel vert ».
Il me semble présent, lisible selon moi, notamment dans un article [12]
de présentation de sa doctrine architecturalo-urbanistique sous forme
de « quartiers autonomes » ou de « villes dans
la ville », système anti-congestionnel se proposant de transformer
la périphérie en autant de « villes autonomes
», système qui s’assimile de toute évidence à
un archipel d’« îles » noyées, selon
les schémas de Léon Krier, dans les « cultures »,
« la forêt », la « campagne »,
mais où la consonnance « autonome » prend un sens
anarchisant ou libertaire, autogestionnaire. Dans ce cas, le complexe métaphorique
de l’ « Archipel vert » se trouve ressaisit par
une ou plusieurs autres structures référentielles sociocritique
et historique, qui viennent alors perturber, ou enrichir, se composer avec,
non pas une quelconque pureté du concepte opératoire rétrocatif
mais avec la singularité du schème référentiel « Archipel
vert ».
Schème d'exploration
de l'univers de références
Il
me faut maintenant revenir sur le fait que le terme « Archipel vert »
n'est pas de même espèce que les autres expressions : « projet-pour-... » ;
il vaut avant tout comme prédicat métaphorique pour aider à
identifier des situations territoriales complexes qui lui confère statut
de concept opératoire pour fonder, former, légitimer une position
de conception. C'est une symbolisation construite, qui implique dans l'espace
d’un projet de conception un agencement de mot-images tels que « îles »
formant un « archipel » dans une « mer »
ou un « océan » qui mobilise un « regard »
analytique pour appréhender un territoire, ses espaces et ses lieux.
Ce prédicat nous l'avons nommé de façon extensive « schème »,
en référence directe aux travaux de Goodman et indirectement à
la catégorie kantienne qui articulait jugement et sensibilité
à un phénomène, à son concept « pur »,
c’est-à-dire débarrassé de ses empiries intuitives
(sensibles). L'activation du concept de schème nous dit la mise en rapport
d’un matériel analytique et symbolique, issu d’un dispositif
de sémantisation tel le « manifeste » koolhaassien.
Il s'active dans une situation de conjecture donnée (un projet pour Courtrai),
avec des objets circonstanciels alors « vus » ou « lus »
comme « débris » d'une urbanisation antérieure
qui reste à infléchir ou conformer. Le schème en ordonne
ainsi la sémantisation ou la symbolisation artéfactuelle sous
forme graphique (croquis, cartographie analytique, photographie sélective,
plan, etc.) accompagnée des formes alphabétiques (notation, texte, ...) ou numérique (dimensionnement cartésien, rapport d’échelle,
surface, etc.). Le schème est une catégorie active de la représentation
symbolisatrice et trouve sa place dans une tentative de compréhension
des procédures référentielles et génératives
de configurations.
Par extension de son domaine d'implication, donc par
transfert de propriétés d'un territoire sémantique à
l'autre, le schème de l’« Archipel vert »
porte à explorer métaphoriquement un univers de références,
à former des paires ou des grappes d'objets porteurs de sens, à
des concepts réticulés, puis à les trier et les ordonner.
C'est pourquoi nous nommons aussi ce genre de prédicats, indissociables
de leur dispositif de termes foisonnants en réseau : schème
d'exploration. Exploration d'un univers de solutions ou de dispositions
potentiellement utilisables par le concepteur dans un cadre donné, et
susceptibles d'engager du matériel projectible. Cet énoncé
tend à distinguer le « schème d'exploration »
du « schème de modification ». Alors que le premier
prélève, instaure et fait venir des propriétés ou
des dispositions de forme à concevoir, le second gère l'adaptation-invention
à de nouveaux contextes de projet et de conception. Mais ils devraient
tous deux être considérés comme une seule et même
entité cognitive saisie à deux moments différents de son
effectivité de conception. S'ensuivra surtout l’examen des modalités
de sélection-évaluation du matériel projectible, à
charge pour le concepteur de le rendre par suite projetable, acceptable par
un contexte situationnel [13].
Ainsi, dans le cas du « Berlin théorique »,
les « îles » urbaines sont les « débris »
non de continents engloutis ou de soulèvements tectoniques, mais d'une
urbanisation ruinée (quartiers, monuments, ce qui subsiste ou sera à
conserver) ; la « mer-océan » est pensée
comme vide d'architecture intentionnellement créé. Les « bâtiments »
(navire-paquebot/construction) détruits par des bombardements, des actions
« sanitaires » ou spéculatives, au lieu d’être
reconstruits, sont remplacés par un « green »,
un continuum paysagé de verdure (landscaping), où
les voies de circulation sont comme les traces des voies de navigation qui reliraient
chaque île.
Le « projet-pour-Anvers » fait
ainsi référence à un « projet-pour-Berlin »
en faisant glisser dans son univers de références tout ce que
le schème métaphorique, opératoire et inventif « Archipel
vert » peut drainer comme transfert d'images et de mots, y compris
ceux ou celles d’un manhattanisme « à rebours »,
involutif. Le schème d'exploration associe entre eux des objet-projets,
lançant ou provoquant une sorte de contamination sémantique de
références de références, de mots et d'images concomitants :
une description géographique et maritime et la description d'une vision
continentale ou « océanique » de l'urbanisation,
son expansion galopante (la marée montante de l'urbanisation), par vagues
successives, extensive et décentrée donc « périphérique ».
Mais grâce à la boussole sémantique du schème d'exploration,
on peut toutefois « lire » (identifier), dans ce « chaos »
à la fois agressif et ludique des topographies localisées, leurs
volumétries existantes, souhaitées ou rêvées, etc.
En fait, lire toute une organisation de monde urbain et ses représentations
d’une véritable way of life, d’un art de vivre collectif ;
et surtout des modalités de description sélective et opératoire,
prédisposant à former du matériel projectible, qui pré-dispose
déjà à reconfigurer les territoires décrits.
Du schème d'exploration aux catégories
du projectible
L'examen
de cette chaîne référentielle engage ainsi une double réflexion.
La première concerne la terminologie de description sélective
et d'invention projective (et leurs valeurs conjointes), mise en place par l'OMA
pour le concours d'Anvers à l'aide de la référence implicite
de l' « Archipel vert ». Fortement métaphorique,
elle permet de comprendre le « projet-pour-Anvers » et
par transitivité d’en décrire une forme atténuée
: le « projet-pour-Courtrai ». La seconde vise les opérations
effectuées à partir de cette terminologie sur le site urbain,
telles que les désigne Rem Koolhaas : (1) identification des « débris »
en deux temps, (2) dégagement de leurs potentialités, (3) traitement
de ces potentialités sur le mode « expressions anti-urbaines »
et j'ajouterai « anti-architecturales ». Pour montrer
l’articulation entre terminologie et opérations cognitives de conception,
nous aurons recours à un extrait du texte de la présentation au
jury du « projet-pour-Anvers », texte rédigé
par Rem Koolhaas peu de temps avant le projet pour Courtrai sous le titre :
City versus Periphery – Nouveaux concepts d'urbanisation. Dans ce texte
nous pouvions lire : « Périphérie
Sur le terrain qui nous est assigné, nous avons
commencé par identifier un certain nombre d' « obligations »
et de possibilités de planifier la ville.
A coté des îles formés par les échangeurs autoroutiers,
une seconde définition des localisations est rendue possible par le niveau
sonore plus ou moins élevé de la circulation.
Aussi bien sur le plan qu'au niveau des intersections, le contour des possibilités
est décrit par d'invisibles enveloppes ainsi créées. Là
où l'utilisation du terrain est discutable, le paysage est créé.
Là où c'est possible, la masse prend forme.
Une fois qu'un inventaire précis a été
réalisé, sept projets indépendants les uns des autres ont
vu le jour. Ils ont ensuite été couchés sur des "vignettes"
séparées.
Dans chaque vignette, une situation spécifique est analysée et,
en tenant compte d'une demande présupposée, réduite à
une condition prototypique qui devient ainsi source d'inspiration pour une nouvelle
typologie.
L'ambition de ces étapes est de consolider des
expressions anti-urbaines (qui à ce jour ont sous-exploité la
ville classique) afin d'en faire de nouvelles générations de matériaux
urbains. [14] »
Suivant
ce paragraphe générique intitulé Periphery, six
autres sont titrés: Transition ; Valley ;
Podium ; Edge ; Dolphin (Figure 3) ;
Landscape. A ces six concepts opératoires correspondent les
sept solutions projetées, localisés dans les « îles
urbaines » (le « dauphin » en rassemble deux).
Dans l'énonciation de ces termes par Koolhaas, comme dans le parcours
du projet pour Courtrai, schème d’exploration, concepts d'urbanisation
et territoires sont assimilés. La logique d'identification ou d’isolation
participe donc autant de l'énonciation du concept le plus adapté
pour nommer un objet-territoire qu'à l'analyse et à la description
du même objet. Mais dans les deux cas, ces opérations d'identification
et de description s'effectueront selon une axiomatique de la dynamique urbaine
contemporaine, consignée dans la doctrine-source de référence
: le manhattanisme, qui se compose de celle, contradictoire du point de vue
de la « culture de la congestion », pour « un
Berlin théorique », complexe référentiel opératoire
étiqueté par le schème d’exploration « Archipel
vert ».
La distribution des métaphores pour Anvers, en
regard des trois métaphores sources du schème d’exploration
du « projet-théorique-pour-Berlin » : « île »,
« mer », « voie de navigation »,
se distribue donc de la façon suivante :
– à « île » correspondent « podium »,
« dolphin », « valley » c'est-à-dire
des masses construites et des masses paysagées telles « landscape »,
« transition », « edge » ;
– à « mer » correspond l'océan métropolitain
d'Anvers et de sa périphérie ;
– à « voie de navigation » correspondent les différentes
voies de circulation qui se raccordent aux échangeurs du Ring road,
lesquels participent à et de la délimitation des « îles ».
C'est le matériel issu de l'application
du schème de l'archipel au site d'Anvers qui engendre pour Courtrai une
logique d'identification permettant de cerner les « débris »,
logique à qui l’on reconnaît ce pouvoir d'identification.
Partant de ce pouvoir et de se savoir-faire, il devient possible de constituer
intentionnellement certains de ces « débris » en
« îles » urbanisées, en décrivant
pour certaines leur potentiel d'urbanité singulière, et en affectant
à d'autres un statut intermédiaire d' « îles »
non ou sous-urbanisées, alors passible d'un paysagisme (landscaping),
figure intermédiaire entre les premières et la « mer
verte ». Ceci signifie que le pouvoir instauratif de ces moyens métaphoriques
est non seulement d'identification (repérage, cadrage) mais aussi de
distinction, de sélection, d'ordonnancement et de projection des prédicats
spécifiques de propriétés voulues, intentionnelles, qui
engageront les solutions projectibles. Lesquelles seront à leur tour
sélectionnées à l'aide d'un système de valeurs cohérent
avec celui de la doctrine de l'« Archipel vert ».
Quand Koolhaas nous prévient que sa « logique
d'identification » n'est pas une « logique rétroactive »,
nous en sommes persuadés. Parce qu'elle n'exerce aucune action immédiate
sur ce qui est antérieur, sur le passé. Sa « logique
d'identification des débris » s'exerce à partir de
la matière de ce passé, ou mieux d'une représentation métaphorique
et métonymique de sa réalité ; elle relève donc
bien, et plus précisément, d'une logique de la référence.
Cette dernière implique des opérations qui se rangent sous les
espèces majeures de relations référentielles telle dénotation,
exemplification, expression, description, possession, représentation,
qui sont aussi des fonctions symboliques où règnent alors le projectible,
c'est-à-dire la projection de dispositions prévisionnelles alternatives,
inventives, attachées à ces « débris »,
les projetant dans l'univers futur d'un devenir-périphérique
reconnu, accepté, puis tendanciellement transgressé, re-délimité.
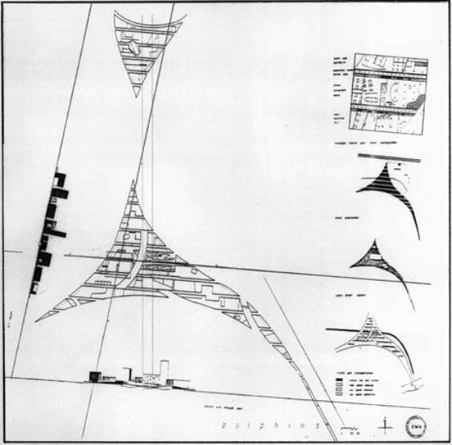 |
Figure
3 (Format original A0)
Page de synthèse graphique de la séquence Dolphin
Redistribution des catégories d'Anvers pour Courtrai
En
fait, le transfert référentiel Anvers-Courtrai ne fut pas si évident
ni immédiat. Durant le projet pour Courtrai, une première phase
a consisté dans une tentative pour trouver des catégories descriptives
« autonomes » susceptibles d'engager du projectible. L'inventaire
de ces catégories était d'abord le suivant : « patchwork »,
« doigt vert », « edge », « nerve
center », « loop », « egg »,
« transition », etc. Mais sans qu'aucune d'entre elles n'ait
permis de concentrer ni fixer les débats autour des rapports entre le
site de Courtrai, son programme et des intentions en devenir.
Lors d'une conférence de fin de journée,
afin de mettre de l'ordre dans l'imprécision des concepts opératoires
et la mollesse des énoncés projectibles qui en découlaient,
Rem Koolhaas décida de trancher en faveur de la désignation d'une
zone unique d'intérêt et de la nommer « île
» (Figure 4 où sont notés, cerclés 1 et 2, les schémas
de R. Koolhas, et Figure 5 comportant leur reprise par Ron Steiner). A compter
de ce moment décisif, les matériaux symboliques déjà
rassemblés se sont redistribués. La création d'un univers
de références recentré sur le dispositif métaphorique
du schème d'exploration déjà expérimenté
et enrichi des acquis du « projet-pour-Anvers ». La chaîne
implicite des relations référentielles qui s'est réimpliquée,
jouent alors son rôle distinctif et organisateur des catégories
latentes, participe de la sélection de tout le potentiel projectible
déjà accumulé, mais sans structure dynamique de synthétisation
configurante.
Cette redistribution des catégories élaborées
s'effectue alors selon l'ordre métaphorique de l’ « Archipel
vert » tel que nous l'avons précédemment déplié :
– « île » rassemble « loop »,
« podium » ou « bastion », « oeuf »,
c'est-à-dire des masses déjà construites ou à surdensifier,
et des masses paysagées telles « landscape », « transition »,
« edge », « bande » ;
– « mer » s'applique à l'espace métropolitain
de Courtrai et de sa périphérie problématique, enjeu du
concours, un composé de ruines d'espaces ruraux gangrenés par
l'urbanisation de lotissements, des établissements industriels et de
service qui, ensembles, avaient suscité les métaphores du « patchwork »
et des « doigts verts » ;
– « voie de navigation » fédère les
différentes voies de circulation qui se raccordent aux échangeurs
du Ring road de Courtrai avec l'autoroute E 17 et les voiries radiales
et secondaires qui serviront à délimiter les « îles »
du Haut Courtrai.
Il est patent que certaines des catégories de
la première phase ont une grande proximité symbolique avec celles
composant la doctrine de référence du premier ordre formée
pour Berlin. Par exemple, la métaphore du « patchwork »
était très proche de celle de l'« Archipel vert »
sans pour autant s'y fondre.
Littéralement, l'assemblage de débris de tissus sans s'attacher
à la continuité des motifs, des couleurs, des textures, permet
de caractériser ou même de décrire métaphoriquement
un territoire qui ne serait plus un « tissu » urbain homogène,
mais un assemblage hétéroclite de fragments d'urbanisation, de
modes de formation incohérents de l'espace urbain, assemblage qui signifie
l'espace « périphérique ». Mais le pouvoir
de l'image s'arrête là, au point d'une identification du territoire,
car elle n'engage pas les modalités actives de sa transformation.
A contrario, le schème de l'« Archipel
vert » (5), radicalisé par Rem Koolhaas [15],
se pose d'emblée, et dans tous les cas, comme prise de position contre
l'architecture, entendre contre le geste architectural perçu
comme inactuelle gesticulation, comme l'un des modes classiques privilégié
de formation de l'espace urbain relevant du non-contemporain. Le geste comme
la geste architecturale doivent, selon Rem Koolhaas, s'effacer par « effacement
post-architectural », et laisser place à un « vide »
de construction qui sera « paysagé ». Par suite,
le projeteur sera contraint d'imaginer le devenir-périphérique
de l'espace urbain contemporain [16]. Dans ce sens, l'effacement
de l'architecture promu par Rem Koolhaas devient selon moi un cas pertinent
d’énonciation des conditions d'une pensée de la périphérie
et de son devenir.
Quant au schème exploratoire, il se présente
comme potentiel pour modifier-modaliser, inventer faire émerger le différent
et le divers. Par l'orientation offensive du fonctionnement référentiel
d'identification et de spécification du schème d’exploration,
il introduit aux schèmes de modification qui ont à charge de rendre
manifeste, en les contextualisant, les propriétés configurantes
nouvellement définies d'un espace urbain, en accord avec les pratiques
sociales-spatiales de son temps.
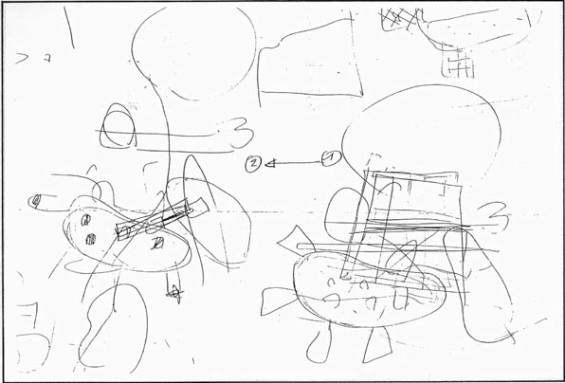 |
Figure
4 (Format original A4) ; schémas dessinés par Rem Koolhaas
:
trace de ses intentions relatives à l’implication du concept rétroactif
« île ».
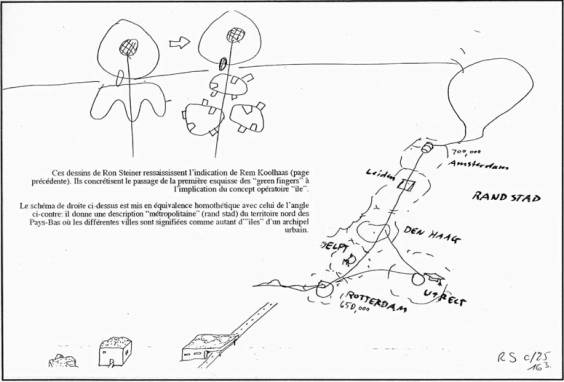 |
Figure
5 (Format original A4) ; tracé par Rem Koolhaas :
Reprise et extension du schéma d’ « isolation » par
Ron Steiner,
responsable du groupe de conception.
Conclusion
Nous
avons posé comme point de départ que « Faire référence
à... » revenait à établir une relation entre
des cas passés et des cas futurs. On s'aperçoit ici que la différence
reste grande entre établir qu'une relation se forme dès le début
de la conception et connaître le déploiement des modalités
du fonctionnement référentiel, dynamique inventive de cognition
configurante. Néanmoins, nous avons pu aborder, imparfaitement il est
vrai, les procédures de référence du projet pour Courtrai.
Et surtout mettre en évidence un dispositif terminologique qui laisse
espérer quelqu'efficacité pour atteindre une compréhension
des heuristiques du concevoir. Elle passe par ce qui ne peut plus être
considéré comme un détour : une théorie de la référence.
Ayant abordé cette question dans le rapport final
du rapport de recherche concluant cette enquête, nous avons provisoirement
fait l'impasse ici sur l'explicitation du système de valeurs a priori,
son évolution, impliquée par la formulation d'hypothèses
référentielles. Nous en dirons cependant deux mots dans ce nouveau
contexte.
Il s'agit évidemment des hypothèses de
solution dont chaque référence est porteuse. Dans le cas étudié
(OMA dans la périphérie), on voit que les hypothèses
attachées au schème d'exploration « Archipel vert »
porte à la fois sur les propriétés en devenir de l'espace
urbain contemporain et sur des hypothèses de solutions projectibles comprenant
ces propriétés et d'autres inventées contextuellement.
On en tire facilement les conclusions suivantes :
Dans ce parcours de conception, nous sommes confrontés
d'abord à une inversion des valeurs latentes attachées à
des représentations classiques et/ou modernes de la ville et de l'architecture,
qui participent à et de l'opération d’« identification ».
Cette inversion des valeurs de jugement manifeste la perte du pouvoir symbolique
de l'architecture et de la ville, perte à laquelle répond la volonté
de constituer « une nouvelle génération de matériaux
urbains ». Cette reconception des matériaux urbains passe
par la définition d'un ensemble de valeurs nouvellement constituées
caractérisant un milieu artificiel « anti-urbain ».
C'est dans cette perspective que nous avons considéré les travaux
de Rem Koolhaas comme exemplaires.
Parmi les trois modes plausibles de références
positives : reconduction d'une hypothèse appartenant à un
cas passé, modification adaptative d'une hypothèse du passé,
abandon des hypothèses de cas passés et formulation d'une hypothèse
nouvelle, il est difficile de situer la chaîne référentielle
de Courtrai. Koolhaas choisit, pour ses conceptions urbaines, la reconduction
d'une hypothèse du passé (Berlin). Mais comme nous sommes placés
devant un cas d'autoréférence et d'hypothèse non encore
confirmée (par l'institution, ses valeurs coutumières), et reconduite
depuis bientôt vingt ans (Berlin 1976, Exposition Universelle 1983, Bijlmermeer
1986, Melun-Sénart 1987, Anvers 1989, Courtrai 1990, ...), nous devons
aussi faire face à la difficulté d'interprétation de ces
trois modes simultanés. La chaîne référentielle que
nous avons analysée et reconstituée traduit en fait la ténacité
avec laquelle Koolhaas cherchait une confirmation de son hypothèse et
des valeurs correspondantes jusqu'à Courtrai. Chaque projet urbain qui
figure un maillon de cette chaîne nous dit la reconduction d'une hypothèse
toujours nouvelle bien qu'amandée, adaptée mais toujours non confirmée
par une instance de validation autrement qu’en projet.
Les chaînes référentielles
changent de statut soit par abandon des hypothèses qui les sous-tendent
au profit d’hypothèses neuves, soit par la confirmation de leur
validité. En choisissant de confirmer l’hypothèse d’urbanisation
d’un autre concurrent, Bernardo Secchi, porteur d’une sorte de néo-réalisme
urbanistique, où l’architectonique et sa geste moderniste règne,
le jury séduit du concours pour le Haut Courtrai refoule l’hypothèse
du devenir-périphérique de l'espace urbain et son corollaire.
Il anéantit d’un coup l'évidence d’une perte radicale
des privilèges classiques de l’architecture quant à la formation
de l’espace urbain, alors qu’il est possible de concevoir et de
mettre en oeuvre, comme le propose Koolhaas, de « nouveaux concepts
d'urbanisation ». Le jury de Courtrai maintient donc, par sa décision
« coutumière », au « projet-pour-Berlin »
un statut d’hypothèse non encore confirmée, et par suite
un statut « théorique », exposé ici, au
jeu de la référence dans le jeu de la conception, sous les espèces
instauratrices et génératives de la chaîne référentielle
et de son schème conducteur.
D.G.
Notes
1.
Plus particulièrement ceux de Nelson Goodman, Faits, fictions et
prédictions, Paris : Editions de Minuit, traduction française
1984, ou encore Langages de l'Art, Paris : Editions J. Chambon, 1990,
pour la traduction française.
2. Telle notre étude : Du
jeu des références et de leurs valeurs dans la description d'un
matériel génératif de la projétation en architecture,
novembre 1992 et janvier 1993, financement du Ministère de l'Equipement,
des Transports et du Tourisme (Lettre de commande n° 89–105/03 du 16/11/1989-MULT/Plan
Construction et Architecture). Cette recherche sur les savoirs de la conception
supposait l’association d’un concepteur et d’un chercheur
responsable scientifique de l’équipe de recherche. Rem Koolhaas
ayant accepté la gageure, j’ai pu suivre in situ et en
temps réel durant plusieurs semaines avec un assistant de recherche,
les développements d'un projet la conception par l'agence O.M.A.,
à Rotterdam. Il s’agissait du « Concours d’urbanisation
Multiple du Hoog Kortrik », lancé par la ville de Courtrai, Belgique,
en 1990 :
« Nous avons l'intention, écrivait Antoon Sansen, Maire de
la Ville de Courtrai, Président de l'Interkommunal Leiedal, de guider
ces développements, afin que ceux-ci contribuent à donner une
structure plus cohérente et identifiable à Hoog Kortrijk. En plus,
nous voulons que, dans l'avenir, Hoog Kortrijk fonctionne comme un quartier
à part entière de la ville. Or, Hoog Kortrijk ne pose pas seulement
le problème de son développement, mais celui de toute la ville
et de la région, vu la tendance indéniable selon laquelle chaque
ville cherche à se profiler pour trouver une place sous le soleil européen.
Partant de ces idées, la Municipalité de Courtrai et l'Interkommunale
Leiedal ont décidé, au début de 1990, d'établir
un concours d'urbanisation multiple de Hoog Kortrijk. »
3. Extrait des entretiens de 1990-1991
avec Rem Koolhaas, reproduits dans le rapport d'étude cité ci-dessus,
IIIème partie, 6-B ; soulignés par moi.
4. Paris, Editions du Chêne,
1978.
5. Ibidem.
6. Son équivalent en matière
de manifeste pour le XXIe siècle serait alors quelque chose comme « la
ville générique » (generic city) de S,
M, L, XL, (Rem Koolhaas, Bruce Mau, Rotterdam : 010 Publishers, 1995).
Le dédoublement actuel de l’OMA (Office for Metropolitan
Architecture), annoncé internationalement par les média comme
on lance un nouveau produit, en AMO dont Koolhaas nous dit qu’elle
est et sera : « a retrospective reading of our own career »
serait sous-tendue de cette appréciation sarcastique : « The
virtual is anything that does not culminate in mass. » in «
Exploring the unmaterial World », by Gary Wolf, Wired, 8.06,
juin 2000.
7. Delirious New York,
op. cit.
8. Rem. Koolhaas, « Imaginer
le néant » in L'Architecture d'Aujourd'hui, Paris,
n° 238, avril 1985, p. 38 ; idem J. Lucan, OMA–Rem Koolhaas,
Paris, Electa/Moniteur, 1990.
9.
« Exploring the unmaterial World », op. cit.
10. N. Goodman, Langages de
l'art, op. cit., p. 127.
11. G. Kubler, Formes du temps
(1962), Paris : Champ Libre, 1973, 64 et suiv.
12. « Doctrine et incertitudes »,
Paris : Cahier de la Recherche Architecturale n°6-7, octobre 1980,
article « Krier ». Notons qu’outre le référentiel
sociopolitique, la référence structurante à « la
ville pré-industrielle » ou « classique »
comme origine a ressaisir de toute urbanisation, est présente, et particulièrement
active dans le montage de ce dispositif doctrinal à triple objet idéel.
Sachant que ce montage fait encore l’objet d’une hiérarchisation
selon les « valeurs d’engagement » du concepteur
en question.
13. D. Guibert, Réalisme
et architecture, Bruxelles, P. Mardaga, 1987; Annexe 1: « Projectualité/projectibilité »,
p. 139. La « projectibilité » peut être définie
comme une activité qui consiste à déterminer les projections
valides à partir de projections réelles (déjà projetées).
Il s’agit alors pour le projeteur de valider une hypothèse de forme,
de configuration, de construction, de coût, etc., déjà confirmée
dans un contexte antérieur, admise comme possible dans un contexte donné,
parmi d’autres tout aussi valides donc rivales. Il sera attribué
à cette hypothèse « projectible » une survaleur
relative en provenance de ses « dispositions », c’est-à-dire
de ses propriétés différentielles ou adaptatives à
la conjoncture. Selon Nelson Goodman (voir note 1), le prédicat « projectible »
relève des prédicats dispositionnels. Il s’inscrit dans
la démarche de projection comme la situation intermédiaire entre
le déjà « projeté »et le « projetable »
(ou le validé).
14.
Cf. note 3 ; description du projet in Dossier n°3
du rapport, traduction Simon Guibert.
15. Rem Koolhaas, « Imaginer
le néant », ibidem, note 8.
16. Sur cette question du devenir-périphérique
de l’espace urbain contemporain, voir : D. Guibert, « Périphérie
5: non-traité des limites, post-architecture », Revue
d’Esthétique, 29, Paris : J-M. Place 1996, § 2 :
« De l’illimitrophe littéral, du discret et du continu ».
De même, voir : « Paris années 20 : extension et périphérie »,
Rome : Metamorphosi, 9, 1986 ; « Imre Makovecz, projet organique,
pensée périphérique », Paris : Techniques
et Architecture, 394, 1991 ; « Périphérie : vide
actif », Paris : Chimères, 175, 1992 ; Des « hybrides
aventureux » dans la périphérie », Lille : Les
cahiers de Philosophie, 17, 1993 ; « Périphérie
6 : l’ubique et le local », Lieux contemporains, Paris
: Descartes et Cie, 1997; « L’entropie des urbanités »,
Paris: Urbanisme, 296, 1997. « Extrapolitains »,
Le philotope, 3, Revue du Réseau Philosophie-Architecture, Clermont-Ferrand
: EACFD/BRA, 1998.